The Goddess of Buttercups and Daisies, de Martin Millar, traduit par Marianne Groves, Gallimard/folio SF, Paris, 2018
La fantasy a beaucoup moins exploré, depuis sa création, les univers inspirés de l’Antiquité méditerranéenne que ceux calqués sur le Moyen-Âge occidental. Nombre d’auteurs, anglo-saxons pour la plupart, se sont néanmoins essayés à la fantasy antiquisante, et l’on dénombre quelques belles réussites dont j’aurai peut-être l’occasion de reparler : la trilogie du Minotaure, de Thomas Burnett Swann ou Lavinia, d’Ursula K. Le Guin, pour n’en citer que deux.
Mes goûts me portent spontanément sur le genre comme sur la période. Alors lorsque je tombe, au hasard de mes raids en librairie, sur un tel ouvrage, il n’est pas rare que je m’en empare. J’ai ainsi pioché, il y a quelques années, un roman de Martin Millar, que je ne connaissais pas par ailleurs : La Déesse des marguerites et des boutons d’or, aux éditions folio, dans la collection SF. Le bouquin a rejoint ma petite section de fantasy à l’antique dans un coin de ma bibliothèque, et y a tranquillement dormi jusqu’au soir où je l’ai exhumé, avec l’intention de le lire enfin. Bien m’en a pris, car cela a été rapide et plaisant.
Même si j’apprécie les bons gros livres de plusieurs centaines de pages qui prennent le temps d’installer un univers et de développer une intrigue, je trouve tout aussi appréciable un livre bref qui se lit rapidement. Ce n’est pas que la lecture doive être un divertissement vite consommé : il est des livres brefs qui sont mal écrits ou qui n’ont rien à dire. Du point de vue de l’écrivain, faire bref n’est pas simple, car il convient de trouver le rythme qui correspond au ton du récit, de ne pas frustrer le lecteur et de ne pas appauvrir l’écriture. Il se trouve que le petit roman (270 pages à peine, assez aérées) de Martin Millar répond à ces trois exigences. J’y reviendrai.
Le cadre ? Athènes, en 421 avant notre ère. La cité subit les affres de la Guerre du Péloponnèse. Le tableau est brossé par très petites touches qui évitent toute pesanteur. Rares sont les descriptions ; elles sont assez brèves (on parcourt l’agora, les quartiers pauvres, la maison d’un riche athénien) mais plutôt évocatrices, même si mes connaissances en la matière ont sans doute aidé à les nourrir ; chaque évocation d’un fait historique ou d’un point de civilisation, est glissée dans le cours du récit (est mentionnée en passant, par exemple, la corde rouge des archers scythes pour réguler l’accès à l’assemblée du peuple lorsqu’un personnage s’y rend) ou dans les discours ou les pensées des personnages (comme la solidarité des membres des dèmes, lorsque l’un des protagonistes évoque sa jeunesse). Aucune note ne vient ralentir la lecture, l’auteur s’étant seulement permis un glossaire à la fin de l’ouvrage.
Ce cadre est bien sûr renforcé par la présence au premier plan de nombreuses figures historiques, parmi lesquelles domine le dramaturge comique Aristophane. C’est d’ailleurs l’une de ses pièces, La Paix, qui est au centre du récit. On croise aussi Socrate, Nicias, et d’autres figures moins connues du profane. Reste à préciser que nous ne sommes pas seulement dans un roman historique, mais bel et bien dans un récit de fantasy historique : l’élément surnaturel est apporté par la mise en scène des dieux qui interviennent, dans la tradition homérique, dans les affaires des humains. Depuis l’Olympe, ils chargent ainsi de diverses missions sur terre des envoyés humains ou semi-divins, qui peuvent les contacter aux autels qui leur sont consacrés. Les dieux sont ainsi le moteur de l’intrigue, qu’il est peut-être temps de présenter.
Athènes est donc en guerre, et la défaite menace. Des pourparlers de paix ont lieu. Le début du roman s’intéresse au sympathique Aristophane, qui fait répéter sa nouvelle pièce, créée pour les Dionysies : la Paix, qu’il conçoit comme une satire des bellicistes, menés par le démagogue Hyperbolos. Mais sa production reste entravée par le camp belliciste, ce qui amène notre dramaturge au désespoir. Entre-temps, Athéna, qui s’inquiète pour sa cité éponyme, envoie à Athènes une Amazone, Brémusa, qu’elle a autrefois sauvée de la mort sur le champ de bataille de Troie pour l’emmener dans l’Olympe. La mission que lui confie Athéna paraît délicate : une prêtresse athénienne, alliée aux bellicistes, a invoqué Laet, la petite-fille – a priori inventée par l’auteur – d’Eris (« Discorde » en grec) à Athènes. Partout où elle passe, Laet exacerbe les tensions et pousse à la violence. La déesse à la chouette s’inquiète pour la cité qui lui est consacrée, et souhaite que Brémusa, de la façon la plus discrète possible, s’oppose aux menées des bellicistes.
Mais Laet n’est pas seule : elle est protégée par Idoménée, un guerrier crétois, qui fut le dernier adversaire de Brémusa sur le champ de bataille. Il s’avère également que Brémusa est un peu rouillée, et que la déesse a la mauvaise idée de lui adjoindre une nymphe, ou plutôt sa fille – car la nymphe a déserté et son temple est en ruines. Là où la nymphe disposait d’un pouvoir de guérison non négligeable, la jeune et ingénue Métris semble n’être dotée a priori d’aucune faculté utile. Brémusa et la nymphe, arrivées dans la ville, rencontrent Luxos, une version athénienne du poète crotté, qui harcèle tout citoyen susceptible de le recruter en déclamant ses poèmes ; au même moment, un problème de taille – au sens propre – vient occuper Aristophane ; et la cité est déjà parcourue de conflits… L’intrigue est posée : je n’en raconte pas plus.
J’ai listé plus haut ce que j’estimais être les trois qualités d’un bon roman bref : les trois éléments sont ici réunis. Le rythme général du récit est enlevé. Le déroulement des événements est assez prenant, car en grande partie imprévisible : on se demande véritablement comment les héros, qui ne disposent de guère d’atouts, vont parvenir à leurs fins. Si l’intrigue est traitée de façon légère, le sujet – la cité en guerre – est évidemment grave. En ce sens, le roman propose le même contraste que la comédie grecque dont Aristophane est le seul représentant conservé. Et même si le style de l’auteur est assez contemporain (on croise par exemple un « ticket de bateau » ou d’autres expressions anachroniques), cela lui évite d’être lourdement ampoulé ou faussement archaïsant. L’écriture évoque ainsi un peu, toutes proportions gardées, la vivacité du style de la comédie antique. La traduction de Marianne Groves, qui est agréable à lire, a sans doute une grande part à cette réussite.
En conclusion, ce fut une lecture fort sympathique, qui n’a bien sûr rien d’un monument de la littérature, mais présente des qualités suffisantes pour mériter l’attention et l’estime. La fiction littéraire est de toutes façons ainsi faite que même si l’auteur ne propose pas de réflexion particulière sur son sujet, celle-ci peut être tirée par le lecteur du cours du récit ; il s’avère qu’une certaine ironie tragique se dégage de la fin du roman pour tout lecteur qui sait ce que l’histoire de la Grèce antique réserve après la Paix de Nicias.
https://www.folio-lesite.fr/catalogue/la-deesse-des-marguerites-et-des-boutons-d-or/9782072736827
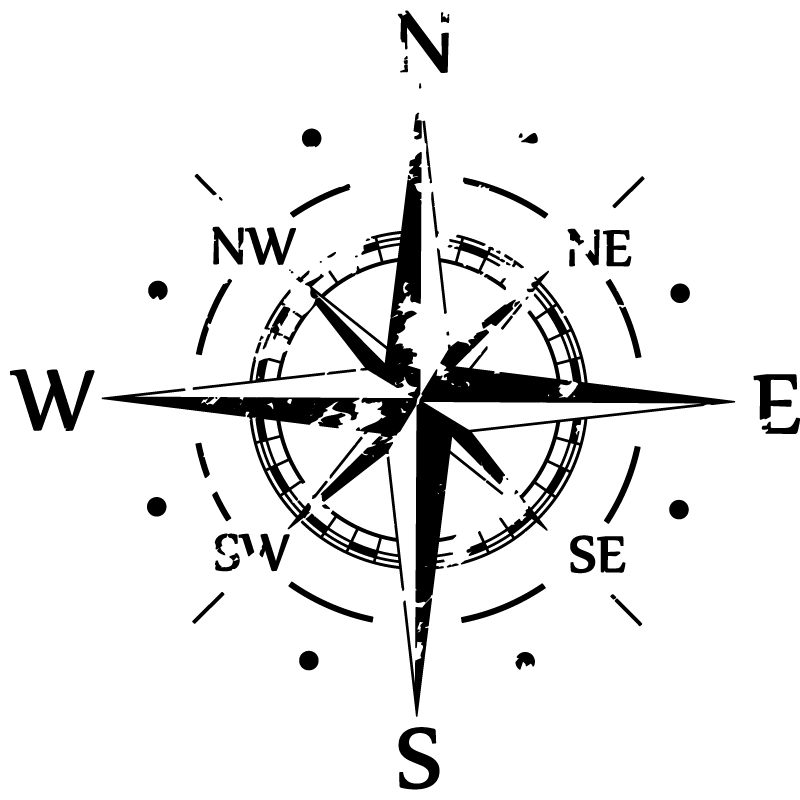
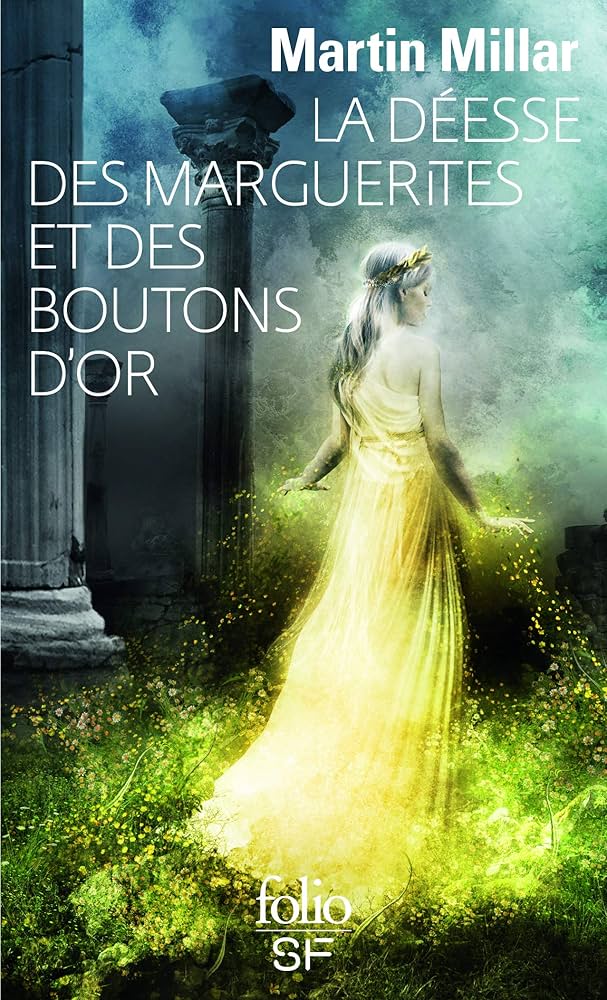
Laisser un commentaire